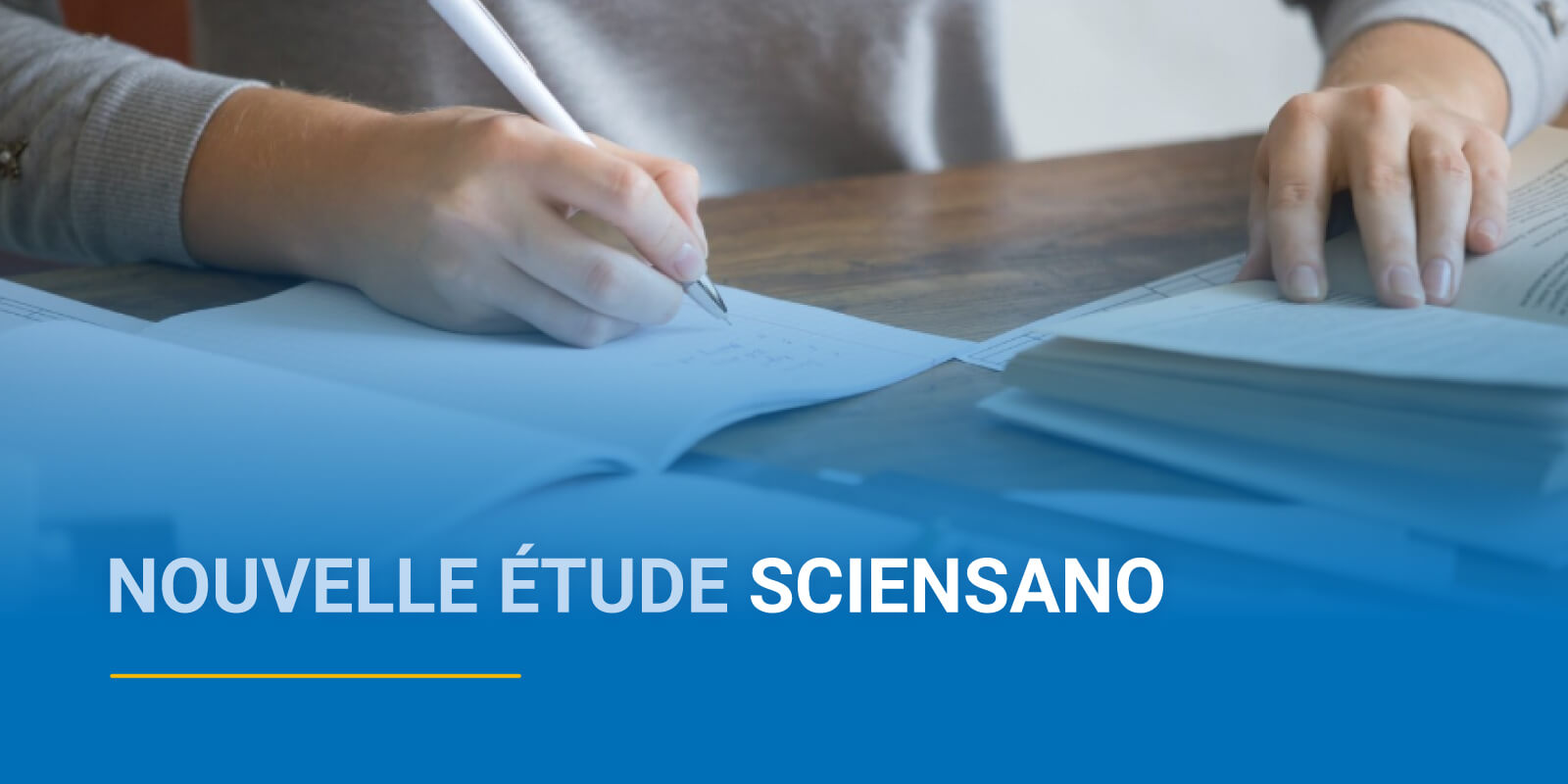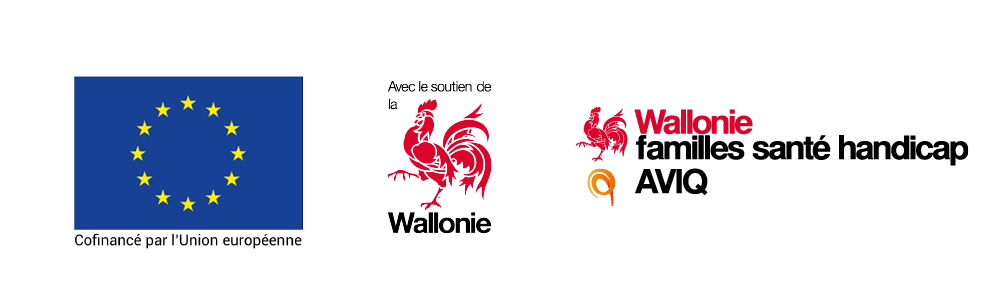Le nombre d’aidants-proches reste élevé en Wallonie
Sciensano a publié les nouveaux résultats de son enquête santé concernant les aidants-proches, ce mardi 28 octobre.
Pour la 3e fois depuis 2013, l’institut national de santé publique a mesuré le nombre d’habitants de 15 ans et plus qui déclarent « dispenser au moins une fois par semaine et à titre non professionnel de l’aide ou des soins à des personnes souffrant de problèmes liés à l’âge, une maladie chronique ou un handicap ». Soit ce qu’on appelle des « aidants-proches ».
Au total, 3.709 ménages ont participé à l’enquête dans l’ensemble du pays, soit 7.001 participants individuels. Sur fond de pénurie d’enquêteurs et d’une réticence croissante des ménages sélectionnés à participer à ce genre d’investigation, les entretiens initialement prévus pour la seule année 2023 se sont étalés jusqu’à la fin 2024.
Les résultats confirment que le nombre d’aidants-proches reste élevé, en Belgique. 13,3% de la population âgée de 15 ans et plus – soit 1,34 million de personnes – se sont reconnues dans la définition présentée par les enquêteurs. Il s’agit d’une hausse d’un peu moins de 111.000 personnes par rapport à 2018, où cette proportion était de 12,2%.
15% d’aidants-proches en Wallonie
Au niveau de la Région wallonne, les résultats publiés sont stables et restent interpellants. La proche-aidance concerne 15% des 15 ans et plus, contre 15,1% en 2018.
Si on y ajoute les moins de 15 ans en se basant sur les résultats d’une étude menée en secondaire en province de Liège par la Mutualité chrétienne et l’ULiège, ce sont donc toujours quelque 700.000 personnes, tous âges confondus, qui se reconnaissent dans cette définition d’une aide régulière et gratuite auprès d’un proche en déficit d’autonomie physique ou psychique, pour le sud du pays.
Dans la réalité, le nombre total d’aidants-proches est sans doute bien plus élevé que ce que ces chiffres officiels laissent paraître. Beaucoup de citoyens ne se reconnaissent pas spontanément dans ce rôle, alors même qu’ils apportent au quotidien une aide ou des soins à une personne touchée par l’âge, une maladie chronique ou aigue (type cancer), un handicap, ou encore une maladie psychique.
Nos constats de terrain montrent, par exemple, qu’un parent qui s’occupe d’un enfant en situation de handicap se définit avant tout comme papa ou maman, et non comme aidant-proche. L’aide et les soins qu’il prodigue s’inscrivent pour lui dans un lien d’amour et de responsabilité, qui dépasse largement la notion d’« accompagnement ».
Il en va de même pour celles et ceux qui accompagnent un proche atteint d’une maladie psychique : la charge émotionnelle est souvent lourde, mais le tabou qui entoure ces troubles rend ces situations invisibles et difficiles à exprimer. Beaucoup d’aidants-proches n’osent pas en parler, par crainte d’être incompris ou jugés.
Il existe une multitude de profils d’aidants-proches, mais il reste souvent difficile pour eux de se reconnaître comme tels, tant il paraît naturel d’aider un proche, parfois sans réellement avoir le choix, ce qui rend leur rôle encore trop invisible.
Différences
L’enquête 2023-2024 de Sciensano contient pas mal d’autres données statistiques intéressantes.
Genre
- Le pourcentage d’aidants-proches est plus élevé chez les femmes (15,3%) que chez les hommes (11,2%) au niveau belge.
- C’est encore plus contrasté en Wallonie (17,4% de femmes pour 12,5% d’hommes) ;
Âge
- Il culmine chez les 55-64 ans (23,2%) au niveau du pays et est également significativement plus élevé chez les 65-74 ans (17,5%), pour baisser ensuite chez les 75 ans et plus (11,5%). Les 25-34 ans (7,7%) et les 35-44 ans (6,4%) occupent le bas du tableau ;
- Le scénario est globalement le même en Wallonie où le pourcentage est le plus élevé chez les 55-64 ans (21,9%), puis chez les 64-75 ans (18,6%), mais cette fois juste devant les 35-54 ans (17,4%) puis les 75 ans et plus (12,1%), le bas du tableau étant occupé par les 15-34 ans (4,7%) ;
Personne aidée
- À l’échelle du pays, 6 aidants-proches sur 10 (58,5%) s’occupent principalement de membres de leur famille qui ne font pas partie de leur ménage, suivis des membres de leur propre ménage (24,3%) et des personnes ne faisant partie ni de leur famille ni de leur ménage (17,1%) ;
- En Wallonie, la part d’aidants-proches s’occupant de membres de leur famille ne faisant pas partie de leur ménage grimpe même à 62%, contre 18,1% qui s’occupent principalement de membres de leur ménage ;
Niveau socio-économique
- Les personnes sans diplôme de l’enseignement secondaire sont beaucoup plus nombreuses à se reconnaître comme aidant-proche d’un membre de leur famille (38,6%) que celles possédant un diplôme de l’enseignement supérieur (18,3%). Sciensano note que la proportion d’aidants-proches s’occupant principalement de membres de leur famille n’appartenant pas à leur ménage augmente avec le niveau d’éducation (35% pour les sans diplôme du secondaire contre 56,7% chez les diplômés du secondaire et 68,7% chez les titulaires d’un diplôme du supérieur ;
Temps consacré
- 3 aidants-proches sur 4 (74,5%) y consacrent moins de 10 heures par semaine, contre 13,7% entre 10 et 19 heures, et 11,7% 20 heures ou plus ;
- Cette dernière catégorie des 20 heures ou plus, toujours selon Sciensano, retombe néanmoins à 7,8% en Wallonie et concerne surtout les 65-74 ans (22,7%) et les plus de 75 ans (14,8%) de même que les personnes sans diplôme de l’enseignement secondaire (18,8% contre 8,3% chez les diplômés du supérieur) ;
Charge ressentie
Par rapport aux enquêtes précédentes, Sciensano a ajouté une question sur la charge ressentie par les aidants-proches. Les résultats donnent ce qui suit :
- 63% des aidants-proches se sentent « pas ou peu stressés », contre 22,3% de « légèrement stressés », 10,5% d’« assez stressés », 2,8% de « très stressés » et 1,4% de « surmenés ». La situation vécue est donc interpellante pour près de 4 aidants-proches sur 10 (37%). Elle est même problématique pour 1 aidant-proche sur 7 (14,7%), ce qui concerne dans ce dernier cas sensiblement plus les femmes (19%) que les hommes (8,5%), différence qui s’accentue encore au niveau wallon (23,4% chez les femmes, contre 7,3% chez les hommes) ;
- 1 aidant-proche sur 4 (25,3%) se sent lourdement chargé chez ceux qui s’occupent principalement d’un membre de leur famille vivant sous le même toit, contre 14% quand le proche-aide ne vit pas sous le même toit et 2,4% quand le proche-aidé ne fait pas partie de leur famille ;
- De même, ceux qui consacrent au moins 20 heures par semaine à ce rôle sont nettement plus nombreux à ressentir une charge lourde (46,1%) que ceux qui y consacrent moins de 20 heures (10,6%).
Recommandations
Au vu de ce qui précède, Sciensano recommande de « fournir un soutien ciblé » aux aidants-proches « qui s’occupent de manière intensive de membres de leur famille vivant sous le même toit ».
L’institut fédéral de santé publique estime également important « de tenir compte des différences socio-démographiques lors de la formulation de recommandations politiques ». En notant : « Les femmes sont plus souvent des aidants informels et se sentent également plus souvent lourdement chargées, ce qui souligne la nécessité de mesures tenant compte de la notion de genre ».
Et Sciensano ajoute : « La prestation de soins informels atteint son maximum chez les personnes âgées de 55 à 64 ans. En raison de l’augmentation de l’âge de la retraite et des besoins croissants en matière de soins des membres âgés de la famille – souvent les parents ou beaux-parents – la pression sur ce groupe va continuer de s’accroître. Il est donc essentiel de soutenir les aidants informels économiquement actifs dans la combinaison du travail et des soins ».
L’institut note, enfin, que « les personnes qui ne sont pas (ou plus) actives sur le plan économique et qui s’occupent intensivement des membres de leur ménage courent un risque accru d’isolement social et méritent donc une attention particulière dans le cadre de la politique ».
Au sein de notre ASBL, nous poursuivons notre engagement à reconnaître, soutenir et défendre les droits de tous les aidants-proches, quelles que soient la nature et l’intensité de l’aide qu’ils apportent.
Nous plaidons avec conviction pour que la proche-aidance soit un véritable choix, et non une contrainte subie faute de solutions adaptées. Pour cela, il est indispensable que des politiques publiques ambitieuses soient menées afin de soulager les aidants-proches et de leur offrir un réel soutien au quotidien.
Le gouvernement fédéral et le gouvernement wallon se sont d’ailleurs engagés, dans leurs accords de majorité, à renforcer la reconnaissance et les droits des aidants-proches — un engagement que nous appelons à concrétiser pleinement.
Nous estimons également essentiel d’aider un maximum d’aidants-proches à se reconnaître eux-mêmes comme tels, notamment à travers de larges campagnes d’information et de sensibilisation. Trop souvent, leur dévouement leur semble naturel, presque évident, au point qu’ils ne réalisent pas toujours qu’ils appartiennent à cette catégorie si précieuse et si généreuse de notre société. Cette méconnaissance les expose pourtant à de réels risques pour leur vie sociale, leur parcours professionnel et leur santé.